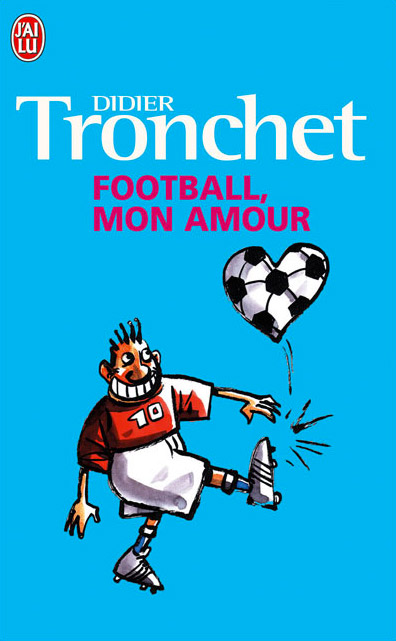Dévoré par son amour du football, l’auteur ne perd heureusement pas son humour en revisitant tous les stades de ses émotions. Que ce soit sur le terrain ou face au petit écran, ses démêlés tragicomiques avec le ballon rond nous font redécouvrir ce qui fait l’essence de ce sport planétaire : un concentré de l’enfance et un miroir de soi-même. Là, c’est sûr, c’est du vécu 100% : on me découvre (pas toujours glorieux) sous les traits d’un footballeur du dimanche, mais surtout vrai malade mental du ballon rond.
« Ce petit livre est un vrai délice »
Michel Hidalgo - FRANCE INTER
« Spirituel et très pertinent »
Didier Braun - L’EQUIPE
« Une savoureuse chronique intimiste »
LE PARISIEN
Format : Poche - 11 x 18 cm
Page : 187
Editeur : J'ai lu (22 mai 2010)
ISBN-10 : 2290014001
– EXTRAITS –
Apologie de la chaussure à crampons
MA MÈRE, en bonne ménagère du bassin minier, avait eu cette phrase définitive, issue d’une philosophie ouvrière de l’existence, qui veut qu’une paire de chaussures, c’est pour la vie : « Je t’achèterai des souliers de football quand ton pied ne bougera plus. » Renseignement pris, ce n’était pas dès que mon pied serait immobile, comme plâtré. Je connaissais bien mon pied, il était incapable de rester en place.
Non, mais c’était presque aussi terrible : ça voulait dire dès que mon pied aurait sa taille définitive. Et que donc, dixit ma mère, le soulier à crampons serait à la bonne taille pour l’éternité. J’ai rapidement calculé, ce serait dans une dizaine d’années. Une autre éternité. Heureusement, ma mère infléchit sa position janséniste devant mon désespoir sans fond et accepta de faire un essai. Un petit pas pour l’humanité, un énorme pour moi. Je n’avais pas mis le pied dans une chaussure, mais dans un autre monde, peuplé de géants en short. C’étaient des Puma, « les mêmes que Pelé », m’a dit le vendeur. Pelé, mon nouveau collègue.
L’AUTRE RAISON de cet achat inconsidéré pour ma mère est que je bousillais toutes mes chaussures de ville (même celles dites « du dimanche », sacrilège), en tapant dans tout ce qui me tombait sous la semelle : cailloux, marrons, boîtes de conserve. Sur le chemin de l’école, il n’était pas rare que je marque quelques superbes buts d’un caillou bien placé dans une vitre. Et, trop modeste, je revendiquais rarement ce geste, face au propriétaire sortant de chez lui comme un diable hors de sa boîte.
AUJOURD’HUI, il n’est pas une paire de chaussures de ville, fût-elle luxueuse, qui me dissuadera d’un match de foot improvisé. La désolation de les voir bouseuses, craquelées, semelles béantes, sera toujours inférieure à la nécessité vitale de taper dans un ballon, inscrite dans le programme génétique de mon pied.
L’ailier transparent
SUR LE TERRAIN, j’étais ailier. Un poste qui a disparu. C’est aux arrières latéraux qu’on demande maintenant de monter sur l’aile, puis de reprendre leur place derrière. (Le défenseur latéral est forcément un recordman du 400 mètres, aller et retour.) Nous autres, feu les ailiers, on ne partait que du milieu du terrain, toujours longeant la ligne de touche, puis ramenant la balle pour l’avant-centre d’une longue hyperbole, un genre de corner mobile, qu’il suffisait de dévier de la tête dans le but. On nous appréciait pour ça. C’était notre boulot.
FALLAIT LES ENTENDRE HURLER, les attaquants, nous supplier, nous mendier : « Centre ! Allez, centre ! », deux bras levés, mains en essuie-glace. Nous avions une position excentrée, marginale, mais nous étions précieux. Pourvoyeurs de ballons décisifs, d’un endroit peu dangereux et méprisé par l’ennemi (la zone doublement cul-de-sac du poteau à fanion triangulaire), mais soudain, hop, dribble surprise, ou centre en pivot, et nous portions le fer jusqu’au cœur de la surface névralgique. Nous étions des incendiaires avec une torche dans le dos.
ET PUIS NOUS AVIONS UN STATUT À PART. Un peu solitaires, ombrageux, fantasques, imprévisibles. De vraies personnalités, un peu comme les insulaires, burinés par la solitude et le vent du large. Nous étions aussi ceux qui frôlent l’abîme de la ligne de touche, sans y tomber, on disait de nos dribbles qu’ils se faisaient dans un « mouchoir de poche ». Ailiers, nous avions des ailes. Nous prisions les grands déboulés aériens, car face à nous on n’avait pas pensé à mettre de gros obstacles, la place forte étant au centre. Tout juste un arrière latéral, poste peu reluisant (on y mettait les toquards qui, s’ils ne faisaient pas de bien, ne feraient pas de mal dans cette zone perdue, ce marais). Dès lors nous les dribblions avec plus d’aisance encore, cheveux au vent.
MAIS VOILÀ, le football moderne nous a remplacés. Nous voici au rebut de la tactique contemporaine, obligés de nous recycler vers le ventre mou des matchs, cette bande centrale du terrain tellement embouteillée aux minutes de pointe. Ne sachant pas bien nous situer, car le danger y vient de partout. Exilés sur le sol au milieu des huées, avec nos ailes de géants (qui nous empêchent de courir).
Orphelins aussi de ce repère intangible tracé à la chaux ; cette ligne de touche qui effraie tant les hommes du centre et que nous autres avions apprivoisée, jouant avec elle comme avec le feu, y attirant sur son bord acéré en bons équilibristes les défenseurs gauches, dont plus d’un tombait les deux pieds dans le vide.
ON NOUS A REMPLACÉS, dans cette entreprise en pleine restructuration qu’est le football moderne, par des employés qui occupent désormais deux fonctions, la leur et la nôtre. Cruelle vexation. L’arrière pourra très bien faire votre boulot, dégagez, on ne peut plus se permettre d’entretenir des danseuses, au royaume de l’efficacité. D’accord, mais un jour vous viendrez nous rechercher, nostalgiques des fiers albatros, après avoir éreinté plusieurs générations de vos pigeons voyageurs latéraux.
MOI, j’avais choisi l’aile, un peu comme on nage à la piscine le long du bord. Cette limite naturelle du terrain était une signalisation rassurante sur les cartes marines de mon football intime, une main courante, un filin de sécurité. Elle ne me limitait pas. Elle me donnait la perspective, le point de fuite. Quand, l’oeil rivé au ballon, je perdais toute polarisation, elle me redonnait le sens du jeu, parent bienveillant qui montre juste la direction, l’impulsion, et m’évite les dangers de l’errance.
L’AVANTAGE de cette excentricité géographique a son revers : on vous y oublie. Combien de matchs ai-je vécus, abandonné sur mon aile déserte ? Combien de fois y ai-je disparu corps et biens, dans un triangle des Bermudes d’indifférence, rejeté à la marge, silhouette floue, dansant dans la chaleur de son désert ? Je devenais un avant-poste des spectateurs, l’un d’eux, myope, qui se serait approché trop près, pour mieux y voir, jusqu’à franchir la ligne blanche ; cette limite symbolique entre l’univers du jeu, hors la vie, et le monde passif. À ces moments, je ne savais plus me situer clairement, flottant entre passivité et action, mort et vif, car une passe inopinée, voire une balle perdue, pouvait à tout instant me ramener au pays des vivants.
IL FAUT DIRE AUSSI que, gaucher naturel, j’avais choisi l’aile gauche bien sûr, peu demandée par la majorité droitière. La concurrence n’y était donc pas rude, et puis il y avait comme une sorte de prédestination (un gaucher pour l’aile gauche) qui désamorçait la contestation, un sceau royal m’accordant naturellement ce poste. Ce don des dieux d’un pied gauche servant à autre chose qu’à monter dans l’autobus me sauva parfois d’avoir à bagarrer pour trouver ma place. Mais l’aile gauche peut être aussi une malédiction. Car l’orientation mentale de la majorité droitière se fait… à droite. Et ils furent nombreux, les meneurs de jeu, à me tourner le dos, obstinément attentifs au tribord, conduisant le ballon vers des territoires encombrés alors que je m’égosillais à bâbord, désespéré d’être si bien placé, totalement seul, et auteur virtuel d’un coup décisif à l’ennemi pour peu que la vigie du vaisseau amiral veuille bien opérer les cent quatre-vingts degrés nécessaires.
VOUS CONNAISSEZ PEUT-ÊTRE les effets psychologiques d’une disparition ? Plus le temps passe, plus on s’habitue à votre inexistence, qui devient patente. J’ai longtemps été un ailier transparent. Et je demande que ce temps de transparence ne soit pas comptabilisé comme des heures de vie (ce qu’il n’est pas), afin qu’au paradis des ailiers me soient un jour restitués ces laps de purgatoire en un long match rédempteur pour gauchers martyrs.
Le rectangle des Bermudes
UN MORCEAU de la surface du globe terrestre, sur lequel on a tracé un rectangle de lignes blanches et planté deux poteaux horizontaux surmontés d’une transversale, n’est plus un endroit comme un autre. C’est un terrain de football.
UN TERRAIN DE FOOTBALL est un univers à lui seul. Il contient les matchs qui s’y sont déroulés, les fantômes des joueurs qui y sont tombés, ont hurlé, ont pleuré. Et même les fantômes de ballons qui fusent dans l’air en silence. Il contient aussi tous les matchs qui s’y joueront encore, potentiel de partie fabuleuse à venir, de buts insensés. Fouler la pelouse d’un stade, c’est habiter un temps en suspens. Un terrain de foot vide vibre quand même. Il n’est jamais au repos.
POUR ÊTRE FASCINANT, le terrain de football n’a pas besoin d’être un stade avec gradins et pelouse. Des buts plantés à chaque bout d’un vague pré bosselé suffisent pour l’inventer. C’était un modeste champ, c’est maintenant une enclave où se pratiquent des lois immémoriales. Celles du football. Sur ce bout de Terre transformé en terrain homologué, l’imaginaire peut maintenant fonctionner. Un terrain vide est comme un écran blanc de cinéma : toutes les histoires y sont désormais possibles.
IL SUFFIT de poser deux sacs au sol, de part et d’autre, et aussitôt toutes les structures d’un vrai terrain de foot sont mentalement reconstituées. Tout le reste s’inscrit en pointillés dans les esprits. N’importe quel footballeur imaginera, en fonction de la largeur des buts, l’emplacement des poteaux et la hauteur de la transversale. (Ça n’ira pas sans quelques contestations : « La balle est dedans ! – Non, elle est poteau », ou encore, plus subtil : « Elle est rentrée avec le poteau… »).
Qu’on installe des buts sommaires, et tous les joueurs sauront à peu près aussi où se trouvent les lignes de touche virtuelles, et les poteaux de corner. Et même la surface de réparation, où les fautes commises revêtiront un caractère de gravité sans commune mesure avec le reste du terrain. La capacité mentale du footballeur à concevoir les structures abstraites d’un terrain non défini est peut-être l’une des clés du succès planétaire de ce jeu.
DÈS QUE le terrain de foot virtuel a surgi du sol, plus rien d’anodin ne peut se passer dans son champ d’attraction. On y respire un autre air. Dix mètres avant, l’herbe semble être la même. Et pourtant non. Au-delà de la ligne de touche, le brin d’herbe est soudain électrique. Quelque chose vibre sur cette surface, quelque chose de l’ordre du sacré. Le non-initié n’a pas perçu la différence, qui traverse, indifférent, ce rectangle de pelouse vide comme n’importe quel pré à vaches. Le footballeur, lui, même modeste amateur, a ressenti les vibrations dans les chevilles, cet appel à courir, à sauter, à voler (sur l’aile).
LE TERRAIN DE FOOTBALL est un champ magnétique. Les deux pôles sont les buts. Ils nous aimantent ; nos corps ne nous appartiennent plus et courent déjà, décérébrés, sous le regard vide du non-initié, à qui ces transes subites sont à jamais interdites.